
“Stories, historias, iсторії, iστορίες”
Martes, Junio24
Le poisson inquiet
Le poisson n’a rien dit. Il est apparu, silencieux, dans les récits, les gestes, les regards.
Free Workshop
À Colón, c’est lui qu’on évoque quand on parle d’eau, sans parler d’eau. Lui, que les familles pêchent moins. « Le poisson », comme réponse à la lutte, lors des entretiens sur les raisons du mouvement de blocage des routes du district de Bocas del Toro, en octobre 2023, et en mai 2025. Lui, dont on craint désormais les entrailles — remplies, peut-être, des produits chimiques déversés par la plus grande mine de cuivre d’Amérique latine. Lui qui se fait trop rare dans la mer des Caraïbes, ou trop présent quand il est invasif comme le « leonfish »
Le poisson devient l’indice d’un monde trouble, d’un milieu devenu brouillé, et de l’effet traumatique de ce bouleversement. on compose avec les déchets, comment compose-t-on avec l’eau qui devient une pollution, un risque sanitaire, un vide dans l’assiette ? Avec « le poisson », comme explication à la lutte ; « la santé des enfants ». passé, présent, futur dans l’oeil du cyclone.
Ce n’est plus un aliment, plus tout à fait une ressource. Il est symptôme. Métonymie d’un environnement où les caniveaux rejoignent la mer sans transition, par un cylindre de béton, enfoui sous le béton qui enserre l’île en ses parties les plus fragiles, où la baignade est parfois remplacée par l’inquiétude. L’algue flotte sur l’eau comme un spectre : on craint sa venue. Terrassée par l’eau, elle se dissout dans le liquide salé, brouille l’élément marins, les poissons disparaissent.
À travers eux, absents, le déchet prend corps. Non plus seulement objet visible, le rebut devient atmosphérique, incorporé, suspecté. Le poisson ne meurt pas toujours du plastique : il vit avec. Et cela dérange plus profondément. Comme si la pollution ne tuait pas, mais empêchait de croire encore à une pureté possible : cette pensée est vertigineuse. Le poisson est le symptôme de l’angoisse du devenir du milieu pollué. Notre place.
Alors, il devient narrateur involontaire d’une île où l’humain et le non-humain cohabitent dans une ambiance altérée. Le pirate bricoleur, les buttes de sable filtrantes, les tas de déchets collectifs… toutes ces pratiques visent à protéger l’eau. Et pourtant, c’est encore le poisson qui dit l’indicible, qui révèle l’angoisse existentielle, le dérèglement sensoriel, la perte de confiance dans ce qui circule entre les pores, les mailles, les mailles de chair et de filet.
Dans cette ethnographie, le poisson n’est pas objet d’étude. Il est témoin. Il est scène. Il est cri muet.
Loin des dénonciations attendues du capitalisme ou du désastre environnemental, c’est par ce silence visqueux, par cette présence animale, qu’émerge une autre lecture du monde : celle d’un vivant composite, inquiet, mais vivant quand même. Un vivant qui compose avec la souillure, avec l’ambiguïté, avec l’eau trouble — sans jamais cesser d’y nager.
Mariculture
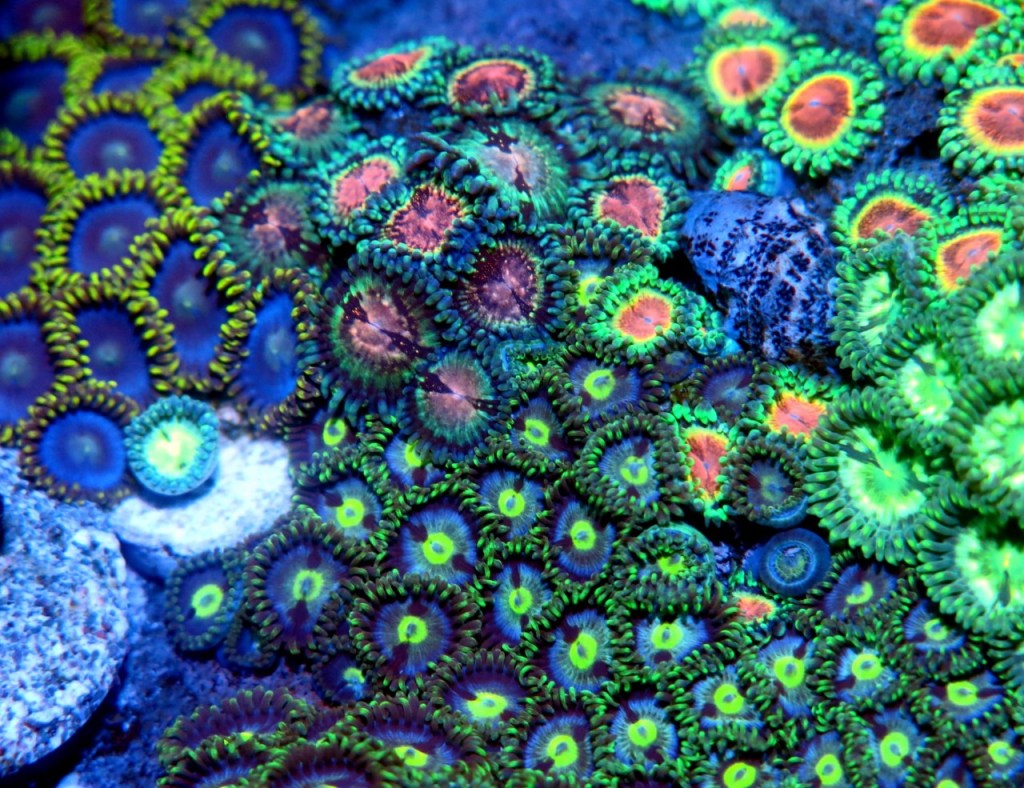
Le poisson comme métonymie traumatique de l’eau
Dans le terrain de Colón, ce n’est pas l’eau, pourtant centrale dans l’écologie insulaire, qui est nommée en premier par les habitant·es, mais le poisson. Une inquiétude récurrente, presque lancinante, porte sur le goût du poisson, sa rareté, sa couleur, parfois son silence. Et pourtant, c’est bien l’eau qui est absente, ou plutôt tue : jamais elle n’est directement nommée comme source d’angoisse, bien qu’elle structure toute vie sur l’île — de la pêche à la baignade, du bétonnage des plages à l’eau purifiée en bouteille.
« Le poisson, ça ne veut rien dire. De qui parle-t-on, de quelle espèce ?
hypothèse : Le poisson apparaît comme une figure métonymique : ce n’est pas seulement un aliment ou une ressource, c’est une manière de dire la mer sans la nommer, de dire le trouble écologique sans en passer par l’abstraction. Il est, comme le dit Max Liboiron à propos du plastique dans le ventre des morues, une surface d’inscription du désordre planétaire. Mais ici, le poisson n’est pas seulement un vecteur de pollution visible : il est affecté, affaibli, déterritorialisé. Il devient la chair du désastre, la preuve comestible d’un milieu brouillé.
Cette métonymie est possiblement traumatique. Dire le poisson, c’est contourner un trauma difficile à nommer frontalement : la perte de l’eau comme milieu vivable. On ne dit pas : « l’eau est morte », mais on dit : « les poissons sont malades ». Le silence sur l’eau pourrait être entendu non comme un oubli, mais comme un déplacement : un geste de pudeur, ou de protection face à l’indicible. Comme si le poisson, habitant originel du milieu, était devenu son messager souffrant.
En suivant cette piste, on pourrait dire que le poisson incarne une angoisse écologique spécifique à l’Anthropocène insulaire : non pas celle d’un événement spectaculaire, mais celle d’une transformation lente, insidieuse, de la mer en substance ambiguë, ni refuge, ni menace absolue — mais médium incertain.
Ainsi, le poisson n’est pas seulement un indicateur biologique : il devient le support d’une parole empêchée, une figure frontière entre le dicible et l’invisible, entre le vivant et le déchet. Il est ce qui reste de la mer lorsqu’elle ne peut plus être pensée comme pure.